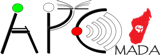« Mais, ce soir, la mitrailleuse racle le ventre du sommeil.
La mort rôde parmi les champs lunaires des lys.
La grande nuit de la terre, Madagascar ! »[1]
Ces vers sombres sortent de la prison d’Antanimora, à Tananarive. Leur auteur, Jacques Rabemananjara, est un poète reconnu. Au moment où il les écrit, il est surtout un détenu politique. Député de Madagascar à l’Assemblée Nationale, Rabemananjara a été arrêté en avril 1947. On l’accuse d’avoir fomenté avec les autres leaders du MDRM (Mouvement Démocratique de la Rénovation malgache) le soulèvement nationaliste qui secoue la Grande Île depuis le soir du 29 mars. L’insurrection a échoué. Les mitrailleuses dont Rabemananjara perçoit le crépitement sont celles des troupes coloniales qui viennent de la briser.
Au sortir du second conflit mondial, à Madagascar comme dans bien d’autres parties de l’empire, la voie assimilationniste[2], empruntée par les mouvements nationalistes de l’entre-deux-guerre, n’est désormais plus d’actualité. L’occupation de l’île par les Britanniques en 1942, l’incapacité de l’administration à faire face à la crise de subsistance, le retour, tardif, des tirailleurs malgaches ayant participé à la libération de la France, l’engagement d’une épreuve de force par le Viêt-Minh en Indochine dès l’automne 1945, tous ces facteurs cumulés ont contribué à saper l’autorité de la puissance coloniale. Les mots d’ordres se sont donc radicalisés sur le thème de l’émancipation et de la pleine souveraineté. Et c’est cette revendication qu’entend porter le MDRM, créé à Paris en février 1946, à l’initiative des deux députés malgaches à la Constituante, Joseph Ravoahangy et Joseph Raseta. Structuré par des membres issus de l’élite merina (l’ethnie des hauts plateaux), le nouveau parti connaît une diffusion rapide dans tout le pays, grâce à un réseau de notables locaux (instituteurs, pasteurs, chefs de canton dans l’administration coloniale…). Il remporte, en outre, toutes les élections organisées sur l’île, raflant les trois sièges prévus par la Constitution aux élections législatives de novembre 1946.
Légaliste et pacifiste, le nouveau parti joue donc le jeu des institutions pour parvenir à ses fins. Le 21 mars 1946, Ravoahangy et Raseta avaient déposé une proposition de loi visant à donner à Madagascar le statut « d’Etat libre, ayant son gouvernement, son parlement, son armée, ses finances, au sein de l’Union française ». Alors président de l’assemblée,Vincent Auriol avait refusé de la faire imprimer et confiera plus tard y avoir lu « un acte d’accusation contre la France et, en somme, un appel à la révolte ». Après cet échec, le MDRM aurait-il alors changé de stratégie et organisé le soulèvement du 29 mars 1947, comme les autorités chercheront à le faire croire ?
Les historiens s’accordent aujourd’hui pour admettre que ces accusations constituent en fait une machination grossière destinée à éliminer ce parti encombrant, en lui faisant porter la responsabilité de la violence. Le pouvoir colonial s’échina même à présenter comme un message codé demandant aux militants de passer à l’action, un télégramme d’appel au calme envoyé, l’avant-veille de l’insurrection, par le Bureau politique du MDRM à ses sections locales (« Ordre impératif est donné à toutes sections, à tous membres MDRM garder calme et sang froid absolus devant manœuvres et provocations toutes natures destinées à susciter troubles sein population malgache et saboter politique pacifique du MDRM ») ! Par leur obstination, les leaders du MDRM sont donc devenus des hommes à abattre et leur organisation est perçue par une bonne partie de la classe politique française comme « un nouveau Viêt-Minh ». Au sein du gouvernement Ramadier, le ministre de l’Outre Mer, Marius Moutet, donne ainsi des consignes pour soutenir une autre formation, minoritaire mais plus docile, le PADESM (Parti des Deshérités de Madagascar), formée par des descendants d’esclaves (les mainty ou « Noirs ») et des notables côtiers de l’Ouest, rivaux des cadres du MDRM qu’ils accusent de vouloir rétablir l’ancienne monarchie merina. La « politique des races » de Gallieni reprend du service…
Mais qui sont dès lors les insurgés ? Parallèlement aux partis officiels existent des sociétés secrètes, comme le Parti Nationaliste Malgache (PANAMA) ou le Jiny. Créées durant le seconde conflit mondial, ces organisations clandestines ont pu capter une partie du mécontentement de paysans que la guerre avait cruellement affectés, entre l’intensification du travail forcé et la crise de subsistance liée aux effets conjugués du blocus maritime et de structures agricoles coloniales tournées vers l’exportation. Beaucoup de militants des sociétés secrètes sont, en outre, issus du PCRM (Parti Communiste de la Région Malgache), acteur important de la contestation nationaliste et de la formation politique du peuple dans les années 30. Depuis l’arrestation de son fondateur, Monja Jaona, en septembre 1946, le Jiny est guidé par Ravelonahina qui en déplace le siège de Mankara à Tananarive où il bénéficie du soutien de Samuel Rakotondrabe, un petit industriel du tabac, également membre du MDRM. Les connexions avec ce parti existent donc, beaucoup de militants des sociétés secrètes prenant leur carte au MDRM sans avouer leur autre affiliation. Mais le Jiny (devenu Jina) dispose d’une base sociale bien plus large et reste résolu à « passer par-dessus » la mouvance légaliste pour la « mettre devant le fait accompli ».
Le samedi 29 mars 1947, donc, à 10 heures du soir, en période de fandroana (la fête ancestrale de purification à Madagascar), l’insurrection commence. Quelques centaines de Malgaches, conduits par d’anciens soldats rapatriés de France et démobilisés, attaquent des postes de gendarmerie, des bâtiments administratifs et des concessions européennes, près de Manakara, sur la côte orientale de l’île. A peu près au même moment, un autre groupe d’environ 2000 conjurés investit la ville de Moramanga et encercle le camp militaire Tristani, après avoir surpris et tué les officiers qui dormaient à l’hôtel : la riposte des tirailleurs sénégalais les contraint toutefois à abandonner le terrain au petit matin, sans avoir atteint leur but qui était de se procurer des armes. Les insurgés parviennent malgré tout à perturber les axes de communication (notamment la voie ferrée) et à entraîner derrière eux une bonne partie de la population paysanne, surtout dans le sud où ils s’emparent du bourg de Vohipeno qu’ils occuperont plusieurs semaines.
En avril, le soulèvement s’étend donc rapidement sur une vaste zone, couvrant une dizaine de districts. Mais les grandes villes restent calmes, tétanisées par l’action du chef de la Sûreté, Marcel Baron, qui organise le maintien de l’ordre à l’aide de ses services de renseignement et de ses brigades spéciales venues des Comores. Sur le terrain, après quelques combats acharnés, la rébellion, armée essentiellement de sagaie et de machettes, adopte une stratégie d’évitement pour pallier le déséquilibre de l’armement. Elle constate aussi que le soutien américain ou sud-africain que des rumeurs leur avaient annoncé ne viendra évidemment pas. Entre-temps, les troupes coloniales qui n’étaient que de 6000 au début de l’insurrection, reçoivent le renfort de parachutistes, de régiments de « Sénégalais » et de la Légion étrangère. Les forces françaises atteindront en décembre un total de 18 000 hommes et font face à un maximum de 20 000 combattants rebelles.
La répression s’engage alors, impitoyable. Encerclés et réfugiés dans les forêts, les insurgés connaissent un répit avec l’arrivée des pluies en octobre 1947, mais perdent petit à petit leurs chefs, tués au combat ou capturés : dans le sud, Radoaroson est abattu en août 1948, tandis que le commandant du secteur nord, le « maréchal » Victorien Razafindrabe est arrêté au mois de septembre. Les opérations militaires s’accompagnent de crimes de guerre : destructions de villages et de récoltes, viols, exécutions sommaires de prisonniers et de non-combattants. Les atrocités perdurent alors même que les troupes coloniales ont partie gagnée : le 5 mai 1948, 166 Malgaches sont arrêtés et enfermés dans trois wagons à bestiaux. Arrêté en gare de Moramanga, le train est mitraillé durant la nuit. 95 personnes sont tuées sur le coup. Les 70 survivants sont emprisonnés et laissés sans nourriture trois jours durant, avant d’être exécutés le 8 mai, devant leurs fosses, sur ordre du général Casseville. Seul un dénommé Rakotoniaina, laissé pour mort dans le train, survécut au carnage et put ensuite raconter cet épisode épouvantable.
Véritable guerre coloniale, l’insurrection de Madagascar et sa répression auront été particulièrement meurtrières. Le nombre de victimes du côté des occupants est d’environ 500 personnes dont 342 militaires, français et africains. On estime, en outre, que les insurgés auraient assassiné jusqu’à 1 900 de leurs compatriotes, membres du PADESM et accusés de collaborer avec les Français. Quant au nombre de victimes du côté de la rébellion, il est bien sûr considérablement plus important. Une estimation communiquée par l’état-major lui-même, à la fin de 1948, évoque 89 000 morts, un chiffre qui a été repris dans l’ouvrage de Jacques Tronchon, édité par Maspéro en 1974, et devenu depuis quasiment « mythique », selon l’expression de Jean Suret-Canale. Récemment, ce bilan a été revu à la baisse par l’universitaire Jean Frémigacci qui, à partir d’une documentation désormais accessible, conclut plutôt à un total de 30 000 morts, dont 20 000 seraient décédés de maladie et de malnutrition dans la forêt, en tentant d’échapper à la traque des forces d’occupation. Quoique nous observions une troublante propension de M. Frémigacci à minimiser la férocité de la répression, comme d’ailleurs son impact traumatique sur les populations, il convient de noter que ce nouveau décompte reçoit aujourd’hui l’adhésion de la plupart des spécialistes.
Qu’elles aient été fauchées par une balle française ou qu’elles se soient éteintes dans la misère et l’isolement des bois, ces dizaines de milliers de vies perdues suffisent néanmoins à placer la tragédie malgache de 1947-1948 au rang des pages les plus honteuses de l’histoire de France, en bonne place dans la longue liste des turpitudes imputables à la colonisation. D’autant qu’à la violence des soldats vient s’ajouter celle de policiers et de magistrats bien peu respectueux du droit. On a déjà évoqué l’emprisonnement du député Rabemananjara et de son collègue Ravoahangy, le 12 avril 1947, alors même que ces deux parlementaires désavouaient le soulèvement et qu’ils étaient couverts par leur immunité. Toujours à Paris, Raseta, n’est arrêté qu’après que l’Assemblée a voté la levée de cette protection. A Tananarive, les chefs du MDRM subissent la torture et finissent par signer tout ce que l’on attend d’eux, aveux, déclarations de repentance, dénonciations de leurs camarades… Dans le même temps, leurs avocats subissent des intimidations et jusqu’à une tentative d’assassinat. En septembre 1948, les parlementaires sont condamnés, au terme d’un procès que l’historien Françoise Raison-Jourde qualifiera de « stalinien » : le bagne à perpétuité pour Rabemananjara (il sera libéré en 1956), la mort pour Raseta et Ravoahangy. Ces deux derniers seront finalement graciés par Vincent Auriol.
Relayée par une presse parisienne aux ordres (à l’exception de Franc-Tireur, L’Humanité ou Combat), la propagande gouvernementale diffuse pendant les « événements » la thèse du complot, tandis que Marius Moutet fait rejeter la commission d’enquête parlementaire demandée par Jacques Duclos. L’objectif est atteint : le nationalisme politique malgache est anéanti. L’efficacité de la manipulation est telle que certains commentateurs (dont Rabemananjara lui- même) en sont même venus à se demander si les autorités françaises n’avaient pas favorisé le déclenchement de l’insurrection pour créer les conditions de la disqualification du MDRM. Cette thèse est toutefois assez peu crédible, d’autant que la France n’avait alors évidemment aucun intérêt à affaiblir son dispositif militaire indochinois en ouvrant un deuxième front à Madagascar. Il est certain, en revanche, qu’à la fin mars 1947, les services de renseignement disposaient d’informations sur l’imminence d’un soulèvement, sans toutefois bien en mesurer la véritable ampleur.
La répression militaire et le nombre de ses victimes déclarées ont manifestement résonné comme un avertissement à l’endroit des populations colonisées d’Afrique qui auraient pu être tentées par la voie de la lutte armée. Quant au traumatisme au sein de la société malgache, il sera profond et durable et pourrait d’ailleurs expliquer, comme l’affirme l’anthropologue Jennifer Cole, la répugnance assez nette des populations rurales d’aujourd’hui à s’engager en politique, et, à plus forte raison, à s’impliquer dans les luttes contre l’Etat. La mémoire de ce que les Malgaches appellent « Tabataba » (troubles, tumulte) est d’ailleurs encore complexe et problématique. La première commémoration de l’insurrection, en 1967 – soit sept ans après la proclamation de l »indépendance –, a été fort timide, ressemblant plutôt à un sorte « d’exorcisme collectif » (Françoise Raison-Jourde). La deuxième République socialiste de Didier Ratsiraka, à partir de 1972, réinvestit ensuite ce passé pour placer 1947 au cœur du récit national : elle renomme les rues, érige des monuments aux morts, inaugure un mausolée abritant la dépouille d’un « combattant inconnu »… Aujourd’hui, le 29 mars est un jour férié à Madagascar et les commémorations sont systématiques. Toutefois, l’implication des chefs d’Etat dans ces célébrations apparaît fluctuante : en 2005, Marc Ravolomanana sidère nombre de ses concitoyens en affirmant que l’histoire de son pays ne l’intéresse pas vraiment et qu’il préfère « regarder vers l’avenir ». Quant à son successeur putschiste, Andry Rajoelina, il a été sévèrement critiqué pour son instrumentalisation sans vergogne de la commémoration, mise au service d’une légitimité douteuse, alors même que sa prise de pouvoir anti-constitutionnelle avait été soutenue par la France !
Dans la population malgache elle-même, il existe une forme d’autocensure autour de l’évocation de cet épisode. Sa potentialité d’événement fondateur de la nation est compliquée par l’échec collectif qu’il symbolise, en particulier dans la capacité des Malgaches à dépasser les clivages « ethniques » ravivés par les politiques coloniales. Depuis quelques années néanmoins, 1947 refait surface grâce à l’engagement et au talent de quelques artistes, comme le réalisateur Raymond Rajaonarivelo, dont le film Tabataba (1988) raconte l’insurrection vue depuis un village isolé, ou encore l’écrivain Jean-Luc Raharimanana, auteur d’une oeuvre habitée par cette volonté de briser la chape de silence qui empêche, selon lui, l’émergence d’une mémoire collective (Nour, 1947).
En France, après le mythe de la responsabilité des « intellectuels hovas » (c’est-à-dire des chefs du MDRM), l’amnésie s’est installée. Il a fallu attendre le voyage de Jacques Chirac à Madagascar en 2005 pour que des mots officiels de reconnaissance soient prononcés : le président français évoqua ces « pages sombres » et « le caractère inacceptable des répressions engendrés par les dérives du système colonial », avant d’honorer la mémoire des victimes des « événements tragiques ». François Hollande lui a emboîté le pas lors du sommet de la Francophonie qu’accueillait Madagascar, en novembre 2016 : « À mon tour, ici même, je rends hommage à toutes les victimes des événements de 1947, aux milliers de morts, et à tous les militants de l’indépendance de Madagascar qui ont été alors arrêtés et condamnés pour leurs idées ». Une lucidité nécessaire mais bien sélective, qui ne s’applique hélas toujours pas à nombre agissements criminels perpétrés après les « indépendances », dans le cadre de « la Françafrique », cet inavouable prolongement de la tutelle coloniale, toujours présente à Madagascar, comme dans bien d’autres pays du continent africain.
Sébastien Jahan
Bibliographie
ARZALIER Francis, SURET-CANALE Jean (ed.), Madagascar 1947. La tragédie oubliée, actes du colloque AFASPA des 9, 10 et 11 octobre 1997, Pantin, Le Temps des Cerises, 1998
COLE, Jennifer. Forget colonialism ? Sacrifice and the Art of Memory in Madagascar. Berkeley : University of California Press, 2001
RAHARIMANANA Jean-Luc, Madagasacar 1947, Vents d’ailleurs, Tsipika, 2008
RAHARIMANANA, Jean-Luc et MEN, Pierrot. Portraits d’insurgés. Madagascar 1947. La Roque d’Anthéron : Vents d’ailleurs, 2011
TRONCHON, Jacques. L’Insurrection malgache de 1947. Paris : Karthala, 1986.
Filmographie
RAJAONARIVELO Raymond, Tabataba, Madagascar, France, 1988, 128′
[1]Jacques Rabemananjara, Antsa, Paris, Présence africaine, 1956.
[2]L’obtention pour les populations colonisées de droits civils et politiques comparables à ceux des métropolitains.